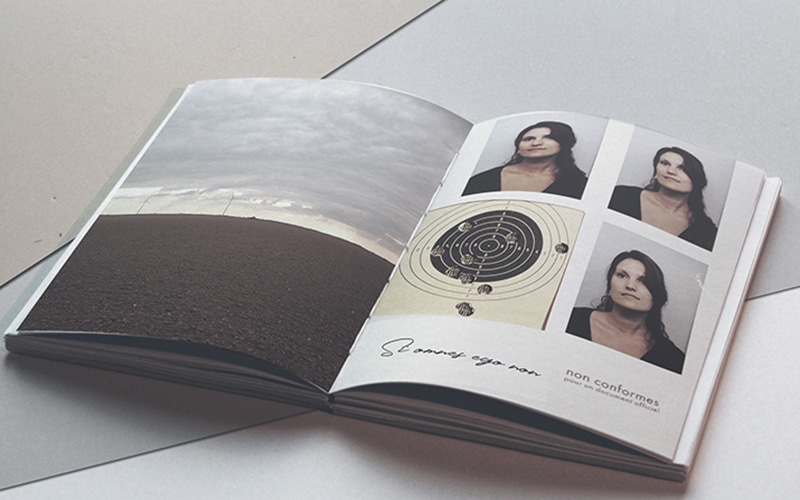Voici un livre qui se sirote comme du petit sang, un sourire carnassier aux lèvres, dans la ouate d’une reconstitution historique minutieuse nimbée de la délicatesse irrésistible d’une plume dont la clarté le dispute à l’entrain. Thierry Laget (écrivain et éditeur de Proust) nous emporte en deux-cent pages trépidantes dans les passions parisiennes littéraires de l’année 1919.
La France tout juste sortie de la Grande Guerre vient de consacrer un auteur bien étrange aux yeux de ses contemporains. Proust, le riche bourgeois de 48 ans, reçoit en effet le Prix Goncourt, destiné pourtant depuis sa création à un auteur pauvre et jeune : « Place aux vieux ! » titre, outré, le journal L’Humanité du 11 décembre. C’est une polémique à plusieurs étages qui s’échafaude bientôt chez les intellectuels patriotes ébouriffés par tant d’audace. Car l’offense profonde est d’une autre nature : Proust, l’opiomane des lettres aux cathédrales de paperolles*, à peine sorti de sa chambre toutes ces années, ose l’emporter sous le nez d’un Dorgelès de trente-trois ans pourtant parti favori avec son poignant récit de guerre apparemment plus en relation avec les préoccupations immédiates des lecteurs.
Lucien Descaves, l’un des plus influents de l’Académie, déclarait à cinq jours du scrutin : « Le grand favori est Roland Dorgelès, dont les Croix de bois et le Cabaret de la bonne femme [sic] ont autant d’admirateurs parmi ses frères d’armes que parmi les non-combattants. Ce sont des livres nerveux, rapides, enlevés. Rien ne les alourdit. Pas de graisse inutile : les muscles sous la peau. »
Il faut dire que depuis le début de la guerre, les écrivains ont bien compris la manne : c’est à celui qui écrira le mieux « l’honneur périlleux de se battre » et beaucoup s’engagent dans le seul espoir de revenir avec une plume glorieuse si l’épée leur en laisse le temps. Fameuses sont ces pages qui soulèvent certaines postures d’écrivains de guerre aujourd’hui aussi vénérés et incontestables que ceux dits « du voyage » ! Si tous, Proust, non. Ce qui l’intéresse, ce n’est pas de chanter l’héroïsme en bataillon contre l’atrocité clinquante et irréfutable d’une tranchée ô combien romanesque, mais bien de ne rien omettre des affreuses médiocrités rampant dans les recoins de son propre milieu, qui peinera longtemps à lui pardonner d’ailleurs.
La presse et les concurrents s’enflamment. C’est un déferlement d’appels aux sentiments ravagés et de recherche de formules assassines : en l’élevant, l’Académie attire sur Proust tous les orages. « ‘L’ombre des jeunes filles en fleurs’ l’emportait sur l’ombre des héros en sang. »
Les partisans défendent, eux, ce choix osé. « Proust, c’est du nouveau. » n’en revient pas Rosny aîné. Valéry Larbaud l’exigeant salue qu’un prix littéraire consacre une œuvre véritablement littéraire.
Le jour du verdict, on peine à joindre le lauréat : Proust dort encore. Il ignorait quel jour exactement était remis le prix.
Et c’est tout un pan inconnu de notre histoire culturelle qui se soulève, sur un tableau vivant animé de nombreux extraits de la presse polémique de l’époque et des correspondances des intéressés. Pour la plupart, ces écrits fougueux vous arracheront de mémorables éclats de rire. Tous, vous en apprendront.
Cent ans plus tard, nous sommes conviés à cette bataille épique, éternellement renouvelée : qui méritera le sucre, l’affreux dehors ou l’hideux dedans ? le jeune arrogant ou le sage asthmatique ?
Pourtant, une question gênante semble pour toujours en suspens : être primé par son milieu n’est-il pas une infamie pour qui voulait en dévoiler les dessous sales ? Il faudra attendre Julien Gracq pour prendre acte, enfin, d’un mémorable et salutaire refus. Plus récemment, Joseph Andras n’a pas accusé réception de son Goncourt du premier roman, rappelant que la littérature n’était pas une compétition. Mais c’est une autre histoire, qu’il me plaira sans doute d’explorer au plus tôt.
Thierry Laget, Proust, Prix Goncourt. Une émeute littéraire, Gallimard, 2019, 260 pages (avec de nombreuses notes, références et annexes de documents d’époque).
* « Marcel Proust pratique l’art d’écrire comme un vice auquel tout est sacrifié ; on sent qu’il prépare son écritoire comme le bambou pour l’opium. » Denys Amiel