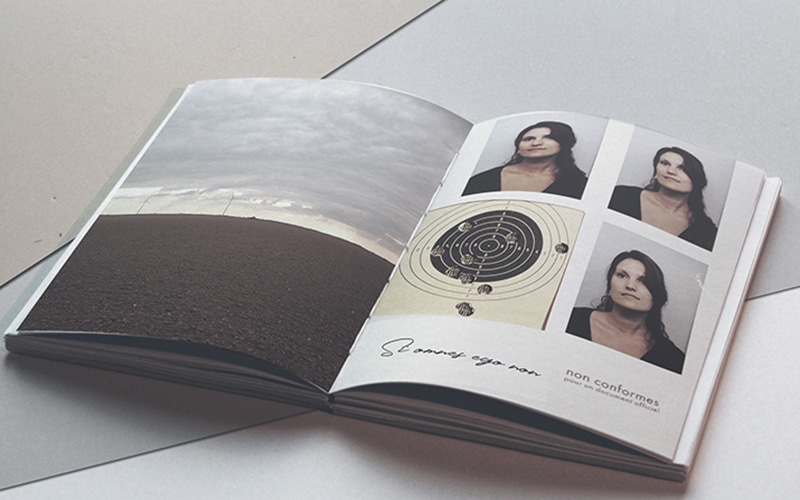« La pièce de Jean-Paul Sartre me déçoit. « L’Enfer c’est les Autres ». Ce mot de la scène V explique l’intention de toute la pièce. Et pourtant nous ne pouvons prendre tout à fait au sérieux cet enfer-là. Nous ne voyons surtout pas pourquoi il nous faudrait attendre la mort pour le connaître, cet enfer, alors que c’est précisément celui dont la mort nous délivre. Il y a là, dans la donnée, un premier principe de faiblesse ; cet enfer où l’en devise tranquillement, cet enfer bavard, cet enfer-là me fait penser à celui du Dialogue des Morts, que personne n’a jamais bien pris au sérieux.
Si d’autre part la pensée de Sartre est que, comme dit le peuple, « la vie est en enfer », il est permis de penser qu’il affaiblit sa thèse en la situant aux Champs-Élysées – et que pour la même raison, ses œuvres romanesques illustrent cette idée avec autrement de force et de vraisemblance que les quelques scènes de Huis-Clos. Mais il faut s’empresser d’ajouter que ces mêmes œuvres romanesques illustrent avec une force et une vraisemblance encore bien plus grandes une autre vérité, qui est le contraire de celle-ci : c’est que l’enfer, l’homme le trouve non pas dans les autres, mais en lui-même : l’enfer c’est moi, c’est ma solitude, c’est ma substance qui se dévore elle-même. Et de cela, je pense que tous les personnages romanesques de Sartre, sans exception, sont l’illustration.
La thèse de Huis-Clos est donc faible, et la pièce souffre de cette faiblesse, comme si, faute de place pour s’expliquer, l’auteur n’avait pas su donner vie à ses personnages, comme il le fait dans ses romans : l’existentialisme n’est pas fait pour l’optique théâtrale.
On ne nie pas l’influence des autres, la place qu’ils tiennent dans notre vie la plus secrète, l’influence que le jugement impersonnel de l’autrui mystérieux, anonyme, a sur notre comportement, et sur nos jugements mêmes de valeur. Mais ce Garcin manque d’étoffe qui ne prend conscience de sa faute que par le miroir accusateur que constitue pour lui la conscience des autres. Il faudrait voir si la société a réellement ce pouvoir de nous imposer, de l’extérieur, le sentiment de notre culpabilité – sentiment qui dépend, certes, de notre relation à autrui, mais qui ne prend toute sa valeur, sa valeur véritablement tragique, qu’au plus profond, au plus vif de notre substance, là où nous cessons d’être simplement le reflet d’une conscience étrangère. Le sentiment de la culpabilité, oui, certes, c’est là l’enfer – et il n’est pas plus grave de se sentir coupable envers autrui qu’envers soi-même. La culpabilité vraiment ressentie élève autrui, en majore l’importance et l’existence : nous faisons alors de l’autre non pas seulement un alter ego, mais quelqu’un qui pour nous juger prend véritablement notre place – quelqu’un – on en revient au mot de Saint Augustin si souvent repris par Du Bos – quelqu’un qui est en nous plus nous-mêmes que nous. Le sentiment de la culpabilité, c’est l’Enfer, parce que c’est Dieu : c’est Dieu qui nous regarde (descipit), nous juge, et nous rejette. D’où il suit que la véritable souffrance de l’Enfer, c’est de connaître Dieu, et de s’en savoir rejeté.
C’est pourquoi, à mon avis, il n’y a pas de véritable enfer chez Sartre : parce qu’il n’y a pas d’enfer athée – il n’y a pas d’enfer sans Dieu, sans la vision de béatitude dont on est privé. L’enfer, c’est toujours un paradis perdu. C’est pourquoi aussi les souffrances de ces personnages, si intéressantes soient-elles pour le psychologue, ne sont pas tout à fait convaincantes, ce sont des souffrances mornes : on vit dans un souterrain, dans une cave, mais on sait qu’il n’y a rien d’autre : cette conscience de la limitation métaphysique de notre vie institue entre les hommes une égalité singulièrement persuasive, singulièrement morne aussi. À vrai dire une seule chose intervient ici pour démentir quelque peu cette impression : la violence avec laquelle ces êtres s’en prennent à leur destin. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, car à vrai dire la révolte ne se justifie que si l’on peut en appeler à quelqu’un. Il n’y a pas de révolte concevable dans une prison sans gardiens, dans un univers privé de maître (faiblesse aussi de la thèse de Camus). Et il n’y a aussi d’enfer que par référence à une condition meilleure. (…) »
Paul Gadenne, L’enfer de Sartre (1947), Une Grandeur impossible, Editions Finitude, 2004.