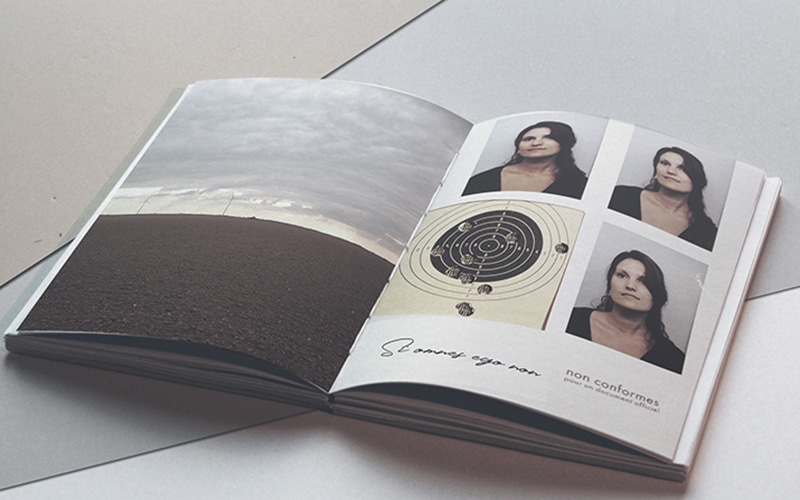« Poème norvégien de Claes Gill :
[Le personnage s’arrête] angoissé au bord du lit du fleuve
Comme attendant la lumière d’un blanc ciel printanier
Traversant en hâte l’obscurité de son œil
Et il énonce ces mots :
Je ne sais rien en dehors de ceci,
Ceci seul : que la vie me vit
Les langues scandinaves disposent de ce que l’on appelle une forme médio-passive du verbe qui, comme son nom savant l’indique se situe grammaticalement et mentalement à mi-chemin entre l’actif (je vis) et le passif résolu (je suis vécu). Or, j’ai traduit par « la vie me vit » pour rendre cette exultation panique, si chère aux Scandinaves, devant la conscience mi-exaltée, mi-désespérée d’une force que la Nature infuse en vous, que vous ne pouvez refuser et qui justifie votre présence ici-bas. »
Régis Boyer, L’originalité des écrivains du Nord, in Pourquoi faut-il lire les Lettres du Nord, page 70.

Soit dit en passant :
« À une époque qui a autant besoin de la peur que la nôtre, il peut naturellement venir à l’idée de certains d’y avoir recours en tant que moyen de jouissance, de voir dans le cours effrayant des événements mondiaux un roman d’épouvante parcouru après minuit et de ressentir, avec une joie secrète, la présence d’un petit tigre bien domestiqué dans leur poitrine. » L’ange de la paix réduit au silence, p61.
Le tigre, Stig Dagerman l’a bien connu. Prophète des glaciers, il se fait ici pourfendeur triste des idées toutes faites d’une Suède dont il scrute les mécanismes, et à travers elle le monde d’après-guerre, dans ces articles rassemblés en un opus paru en 2009 chez Agone.
« Parler de l’humanité, c’est parler de soi-même. Dans le procès que l’individu intente perpétuellement à l’humanité, il est lui-même incriminé et la seule chose qui puisse le mettre hors de cause est la mort. Il est significatif qu’il se trouve constamment sur le banc des accusés, même quand il est juge. Personne ne peut prétendre que l’humanité est en train de pourrir sans avoir tout d’abord constaté les symptômes de la putréfaction sur lui-même. Personne ne peut dire que l’être humain est mauvais sans avoir lui-même commis de mauvaises actions. En ce domaine, toute observation doit être faite in vivo. Tout être vivant est prisonnier à perpétuité de l’humanité et contribue par sa vie, qu’il le veuille ou non, à accroître ou à amoindrir la part de bonheur et de malheur, de grandeur et d’infamie, d’espoir et de désolation, de l’humanité. » Le destin de l’homme se joue partout et tout le temps, p 37.
Ici point d’aigreur. Point de personnages ou de plumes privées de leur grandeur, injustement méconnue d’un peuple stupide. Le peuple d’après-guerre, probablement fantasmé comme mêlé sans plus de frontières en une aiguë connaissance de l’enfer, aura vite oublié les décombres, certes, mais saura aussi reconnaître l’amertume comme une nécessaire sincérité. Le succès, Dagerman l’a immédiatement rencontré. Je ne peux savoir ce qu’il en coûte de prendre la parole après la pluie de cendres, un mince 11 septembre n’ayant pas réussi à percer la carapace blindée des chars aux feux médiocres, et vite éteints, que sont les cerveaux des preneurs de parole. Je ne peux que rester humble et refuser l’analyse qui s’éloigne, chaque minute, un peu plus de moi, prise d’assaut par la nécessité urgente de sortir les corps encore chauds des gravats. L’autopsie viendra plus tard, en arrière-chambre, pratiquée par les plus sages que moi. Je ne peux pas comprendre, dans cette perpétuelle lutte pour sauver tous ces livres, s’il fallait de l’inconscience, de l’oisiveté, du génie ou une incroyable propension à se retirer derrière des lignes plus importantes que soi, pour écrire, à peine tiré du désastre. Ce qui est sûr, c’est que ces écrits amers font entrevoir un esprit libre car déjà retiré. Le succès ne suffit pas, l’amour ne suffit pas, la liberté, absolue telle que recherchée par l’auteur, ne souffre plus aucune de ces actions répugnantes que la vie voudrait nous voir endosser sans broncher. Mais la sagesse d’un trentenaire qui n’a jamais joui d’une jeunesse lumineuse, cette sagesse se refuse à aller trop vite en besogne. Aucune formule péremptoire ne vient sanctionner une pensée évolutive, bien que toujours vissée au fond, au point que l’on soupçonnerait parfois Dagerman de forcer une légèreté à laquelle il a renoncé pour toujours. Toujours, pour l’auteur, s’arrête demain. Il est d’autant plus facile d’être décontracté.
« Ce que je veux dire, c’est ceci : voyagez, étudiez ou prenez un emploi. C’est vous qui savez le mieux ce qui vous convient. Mais, quoi que vous fassiez, n’oubliez jamais de vous dire que vous n’êtes pas prisonnière de la voie que vous avez choisie. Vous êtes pleinement en droit de changer d’itinéraire si vous estimez que vous êtes en train de vous égarer. La vie exigera de vous des prestations qui vous paraîtront répugnantes. Il faut donc que vous sachiez que le plus important n’est pas la prestation mais ce qui vous permettra de devenir quelqu’un de bien et de droit. Ils seront nombreux à vous dire que c’est là un conseil asocial, mais vous n’aurez qu’à leur répondre : quand les formes de la société se font par trop dures et hostiles à la vie, il est plus important d’être asocial qu’inhumain. » L’avenir radieux…, p 93.
Ce dernier extrait est assez troublant. Il est tiré d’une lettre écrite en réponse à une lycéenne lui demandant comment envisager l’avenir, le tout étant un exercice littéraire publié dans une gazette dont le nom importe peu. Dagerman lui demande de ne pas oublier la liberté et l’amour. Il lui souhaite sincèrement bonne chance et lui demande de lui écrire dans 10 ans pour lui parler de son chemin. Nous sommes alors en 1952, l’auteur se suicidera deux ans plus tard. Il ne le sait certainement pas encore, ni personne alors, mais nous, lecteurs, le savons. Et nous prenons un pluriel au passage, victoire furtive sur le singulier coutumier des textes acides qui dessoudent nos carcasses de celles des autres.
Je voulais simplement écrire sur ceux qui sont morts, et rentrés chez eux, qui avaient dans leurs lignes quelque chose qui fait mal. Je les embrasse, je les honore, mais ne les disséquerai pas.